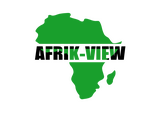Cet événement inédit a été la première réunion de ce genre depuis près de 46 ans, pourtant, les enjeux étaient grands, parmi lesquels l’Afrique et ses immenses ressources en eau.
De ce fait, pour limiter les tensions liées aux pénuries d’eau, l’un des principaux axes sur lesquels l’ONU a eu à travailler, était de pousser et d’encourager une plus grande coopération transfrontalière en partage de l’eau. Pour cela, elle s’est appuyée sur un outil précis : la Convention de l’eau de 1992.
De nombreux pays africains ont manifesté leur intérêt pour cette convention sur l’eau. Car au départ, c’était une convention entre pays européens pour préconiser les obligations des pays qui partagent des ressources en eau comme un fleuve, une rivière ou dépendent du même bassin aquifère.
Mais alors, depuis 2016, tous les pays du monde peuvent la signer. C’est devenu comme une convention cadre, qui permet à des pays voisins de poser des principes de mise en commun des ressources ou d’infrastructures comme des barrages. Parce que environ 153 États dans le monde partagent les mêmes bassins aquifères.
On souligne notamment un fort intérêt des pays africains pour cette convention. Le Nigéria l’a rejoint comme annoncé depuis le 22 mars. Il devient ainsi le septième État africain signataire et sera suivi par la Gambie, la Côte d’Ivoire, la Namibie les prochains mois. La RDC, la Sierra Leone, la Tanzanie et l’Ouganda sont également intéressés.
Notons que entre le réchauffement climatique et la pression démographique, il y a un vrai besoin à canaliser ces eaux partagées, d’autant que 90% des ressources en eau en Afrique sont transfrontalières. Plus concrètement, il s’agissait de se questionner sur comment gérer le fait par exemple que le Nigéria passe de 200 à 400 millions d’habitants d’ici 2050, alors que plus de 60% de la population vit dans le bassin aquifère du Niger, qui est partagé par neuf pays ?
Le pays va ouvrir une réflexion avec ses voisins. Et puis, les pays africains sont habitués à la coopération dans ce domaine. Ils ont été pionniers en la matière, en ayant mis sur pied dès les années 1970 des mécanismes de gestion des fleuves en commun, comme celui du fleuve Sénégal, entre le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. Là, avec ce traité, ce sont non seulement les eaux de surface qui sont encadrées, mais aussi les eaux souterraines qui jusque là, n’étaient absolument pas régulées.
D’après le World Resources Institute, une ONG environnementale internationale, le processus de sécurisation de l’eau pour nos sociétés d’ici 2030 coûterait juste un peu plus de 1% du PIB mondial, avec un retour sur investissement immense.
Les pays du Sud étaient donc au centre des débats, en particulier ceux africains. La question du Nil a été abordée, car il constitue un intérêt majeur pour l’Afrique.
« Il y a déjà des tensions inhérentes à la gestion, par exemple, transfrontalière de l’eau de fleuve, je pense au Nil. Et ces tensions vont s’exacerber dans un monde où la ressource en eau va être plus chère, va être moins abondante », nous révèle Jean Lapègue, représentant d’une coalition d’ONG française.
Dans ce cas, l’objectif premier de cette conférence spéciale des Nations Unies était d’améliorer la gouvernance mondiale de l’eau pour se préparer à l’avenir. Les ONG réclament un envoyé spécial de l’ONU chargé de ces questions et des efforts financiers supplémentaires.
Rappelons que d’après les Nations Unies, environ 2,3 milliards d’habitants vivent dans des pays en situation de stress hydrique et 02 milliards n’ont pas d’accès à l’eau potable.
Près de 6 500 participants étaient présents à cette conférence pour plus de 500 événements. En plus de cela, l’on a assisté à des engagements concrets, car même si aucun accord politique général n’était prévu pendant cette conférence spéciale, l’ONU a réquisitionné de ses pays membres plus d’engagement et ceci sur tous les fronts.
Pour résoudre de grands maux, il faut de grands moyens. D’après la science, un Homme ne peut survivre que pendant 03 jours sans eau. Alors, un véritable retour à l’ordre s’impose.