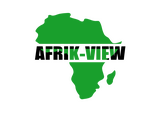Repérage des sources d’eau
L’eau est constituée de plusieurs molécules de H₂O. Une molécule de H₂O est composée de deux atomes : un atome d’oxygène (O) et un atome d’hydrogène (H). Il existe des variantes d’un même atome, appelées isotopes. Ce sont des éléments ayant les mêmes propriétés chimiques (même nombre d’électrons et de protons) mais des propriétés physiques différentes, notamment une masse différente due à leur nombre de neutrons. C’est un peu comme des vrais jumeaux : ils ont le même génotype, mais pas le même phénotype. Par exemple, pour l’hydrogène, on a H¹, H² (deutérium), H³ (tritium), et pour l’oxygène, O¹⁶ et O¹⁸. Ainsi, certaines molécules d’eau sont plus lourdes que d’autres à cause des différents isotopes d’hydrogène et d’oxygène qui les constitue.
Comment se fait le repérage des sources d’eau ? Parlons de la pluie. Pour qu’il pleuve, il faut d’abord que l’eau s’évapore et forme des nuages. Les molécules d’eau contenant des isotopes légers s’évaporent en premier et forment les nuages. L’eau dans ces nuages possède une composition isotopique bien spécifique, presque unique, qui constitue son empreinte. Il en va de même pour les molécules contenant des isotopes plus lourds. Lorsqu’il pleut, les gouttes contenant des isotopes lourds tombent en premier, donc plus proches de la source d’évaporation, tandis que celles avec des isotopes plus légers tombent plus loin sur la surface terrestre. Dans le but de déterminer l’empreinte (c’est à dire les différences de masse dans les molécules d’eau) afin de remonter à leur origine, les hydrologues font usage des techniques d’hydrologie isotopique. Elles consistent en l’utilisation des isotopes pour estimer l’âge et les origines de l’eau, ainsi que les mouvements dans le cycle hydrologique.
Ces techniques ont déjà été, et sont encore, largement employées dans le cadre des projets menés par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) en Afrique du Nord, notamment en Tunisie et au Maroc, ainsi que dans la région du Sahel, Afrique de l’Ouest et Centrale, où des pays comme l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Sénégal, et le Tchad les utilisent. Elles permettent d’analyser et de cartographier les ressources en eaux souterraines.
L’âge de l’eau et taux de réalimentation des sources d’eau
Oui l’eau a bien un âge ! L’eau contient des radioisotopes (ce sont des isotopes mais qui sont radioactifs) naturellement présents comme le krypton 81 (Kr-81), le carbone 14 (C-14), le tritium (H-3) qui permettent de déterminer son âge grâce à des techniques d’analyse spécifiques comme la spectrométrie par analyse laser. En effet, en mesurant la quantité de ces radioisotopes présents dans une source d’eau, on peut savoir si l’eau est jeune c’est à dire constamment réalimentée, ou si elle est vieille c’est à dire très peu ou pas réalimentée. En connaissant l’âge de l’eau et son taux de réalimentation, il devient par exemple possible de savoir si c’est une bonne idée de creuser un forage ou un puits dans un endroit sans risquer un tarissement rapide. Le Niger qui, victime de sa situation au cœur du Sahel, subit régulièrement des pénuries d’eau ; a signé en mars 2025 un accord avec l’AIEA pour la construction d’un nouveau laboratoire d’analyse de l’eau. Il y sera question d’utiliser les techniques d’hydrologie isotopique pour mieux comprendre comment l’eau se déplace entre les rivières, lacs et réserves souterraines afin de la gérer efficacement.
Détecter et prévenir la pollution des eaux
Les techniques d’hydrologie isotopique permettent également de détecter si une eau est contaminée par la pollution ou par l’intrusion d’eaux salées. L’une des pollutions les plus courantes est celle causée par les nitrates (NO₃⁻), qui résultent de l’interaction entre l’azote (N) et l’oxygène (O). Les méthodes chimiques peuvent déterminer si une eau est polluée, mais elles ne permettent pas d’identifier l’origine de cette pollution. C’est là que les techniques isotopiques interviennent : elles analysent la composition des isotopes présents dans l’eau afin de retracer leur source.
L’azote peut provenir de différentes sources, comme les engrais agricoles (NPK : Azote-Potassium-Phosphore), mais aussi des détergents de lessive utilisés dans les foyers. Chaque source contient des isotopes d’azote ayant des poids légèrement différents. Grâce à cette différence, il est possible par exemple d’identifier si la pollution en ions nitrates provient de l’agriculture, des rejets domestiques ou d’une autre activité humaine. Ces analyses permettent donc de mieux comprendre les causes de la contamination des eaux et d’adopter des solutions adaptées.
Le dessalement de l’eau
Dans le monde, près de 300 millions de personnes dépendent du dessalement de l’eau de mer, selon l’International Desalination Association (IDA). En effet, 40 % de la population mondiale réside à moins de 100 km de la mer. Le dessalement permet de fournir de l’eau potable dans des zones où les ressources naturelles subissent un effet de salinisation. Le processus de dessalement utilise la chaleur et l’électricité produites par une centrale nucléaire pour éliminer le sel et les minéraux de l’eau de mer par distillation ou séparation membranaire. Comparées aux autres méthodes de dessalement utilisant les combustibles fossiles, elle présente de nombreux avantages tels qu’une faible empreinte carbone, un coût intéressant, un accès abordable à l’eau potable pour des milliers de communautés en zones arides ou semi-arides et, une potentielle faisabilité grâce aux petits réacteurs modulaires.
Le manque d’eau douce ne menace pas seulement les pays enclavés, mais aussi les petits États insulaires en développement et les territoires côtiers. Or, l’eau est essentielle au développement, que ce soit pour la santé, l’agriculture, l’environnement, l’industrie ou l’énergie. Les techniques nucléaires, notamment celles de l’hydrologie isotopique, permettent d’évaluer la quantité, la qualité et la durabilité de l’eau, contribuant ainsi à une meilleure gestion des ressources hydriques.